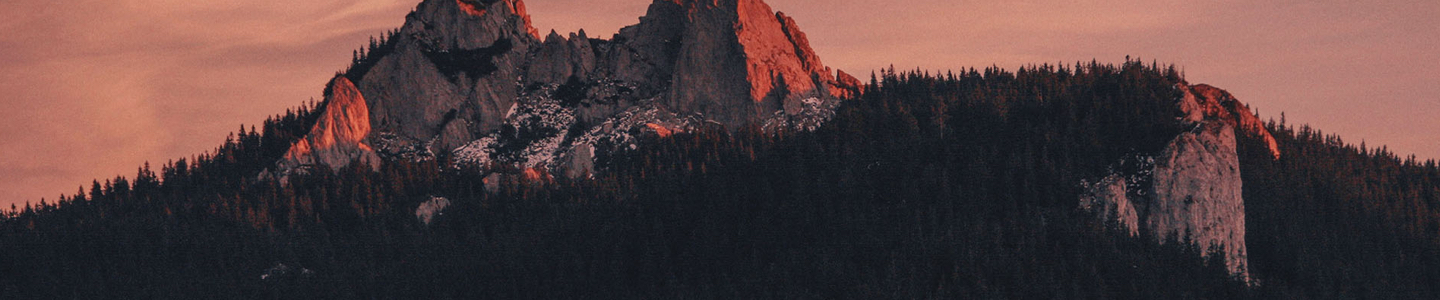
vincent-bonnefille
Vincent Bonnefille
<
Illusion d’exhaustivité
C’est donc en cherchant quelque chose (ou en ne cherchant rien) qu’on découvre autre chose d’une importance considérable, voire capitale, ce qui nous ramène inévitablement au «quotidien et ses tentatives d’épuisement». Étymologiquement, le mot épuiser tire son origine du mot puits, que l’on met à sec en en tirant toute l’eau qu’il contenait, d’où le trope vers un tarissement des énergies vitales, c’est-à-dire causer la disparition de quelque chose, utiliser complètement (Antidote 8, v. 5.5) ou, par analogie, la relève de l’entièreté des données dans un recensement. Épuiser un sujet implique aussi d’une certaine manière en tirer toutes les possibilités réflexives en l’observant de façon exhaustive.
>
<
Comme la sérendipité, l’exhaustivité est une francisation du mot anglais exhaustion, néologisme tiré du latin exhaustum: «vider en puisant», de haurio: «tirer, et ex: hors de» (Gaffiot, 2011: 279-336). Le terme est créé par le philosophe britannique Jeremy Bentham
>
<
Confortablement installé à la terrasse du café de la mairie, place St-Sulpice, Perec recense ce qu’il appelle l’infraordinaire, ou comme il l’explique dans un dialogue avec Bernard Noël, «ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance: ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages» (Bellos, 1994, 37).
>
<
la présence devient un effet lorsqu’un objet suscite une réaction ou, du moins, attire l’attention par le seul fait d’être présent, le fait d’être là, à un endroit en particulier, à un moment donné
>
<
Dans son Trajet de l’œil, Bernard Noël écrit «[v]oué à la réalité, il y a un moment où j’écris ce que je vis, et un autre où ce que j’écris me vit […] L’écriture chemine depuis la périphérie de la conscience jusqu’à ce centre où rayonne l’œil qui la voit, se voit, me voit, se voit me voir, et par conséquent m’écrit» (1988: 69-70).
>
<
Pour en revenir à l’intention à l’origine de ma réflexion, Edmundo Morim Carvalho, dans son étude sur le Paradoxe de la recherche, définit la sérendipité comme «l’art paradoxal de se laisser surprendre par les phénomènes quand rien ne prédisposait d’accorder de l’attention à ce qui n’était, à première vue, qu’un accident, une insignifiance, un bruit de fond dépourvu d’intérêt» (De Carvalho, 2011: 387).
>
<
«ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance: ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages» (Bellos, 1994, 37).
>
Highlights
R))
L'épuisement littéraire/artistique ou comment s’intéresser sur le banal, sur ce qui ne faisait pas art/litterature.... avant que Blanchot et autres ne défassent ce qui faisait l'auteur et réinventent leur art.
R) < L’article qui suit détaille deux cas littéraires qui articulent, chacun à sa manière, la logique de l’épuisement: le cas des fictions de Maurice Blanchot, qui prennent comme centre l’exténuation de la voix narrative, et celui de la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec, qui se présente comme un travail exhaustif d’inventaire du réel. >
-----
Blanchot, récit du désœuvrement + chambre ::::::
< Frances A. Yates (Yates, 1966), selon laquelle les Ars memoriae antiques sont en fait des manières d’articuler des espaces imaginaires de la mémoire (Yates, 1966), il est possible de lire les arts du récit de Blanchot comme des architectures mémorielles. Les «lieux» que ceux-ci cherchent à instituer ‒ceux des chambres et des pièces closes où errent ses personnages fictionnels‒ peuvent certes se comprendre comme les gouffres de l’oubli, mais aussi comme les facettes plurielles d’une mémoire alitée, immobilisée et exténuée, qui possède sa propre temporalité. >
+ R)
< [...] l’œuvre blanchotienne fut, par sa poétique du désœuvrement et de l’épuisement, un refus radical de la mythification de la littérature >
+
mort du sujet (litterraire, auteur, sujet)
< L’écriture fictionnelle de Blanchot, qui se veut le lieu où le sujet trouve la mort,n’est pas la simple négation de la subjectivité narrative et de l’écrivain. Elle est la cristallisation d’une poétique de l’épuisement à travers laquelle le sujet, loin d’être nié, retrace ses contours sous la forme spectrale et désœuvrée d’un être «qui suppose sa mort antérieure».À la fois architectures de l’oubli et de la mémoire, cette poétique garde en elle les traces d’une narrativité et d’une subjectivité autre qui, à l’orée même de sa disparition, mettent en lumière la figure de l’écrivain anonyme. Dès lors, c’est le mythe même de la littérature, mais aussi, en filigrane, la figure de l’écrivain moderne qui – disparaissant et s’effaçant dans le langage littéraire – [...] >
C)
< Si Blanchot tente d’épuiser la littérature de l’intérieur, ce n’est que mieux rétablir l’éclat de son mythe et sa mémoirequi en sont venus à se fragmenter à travers les désastres et les catastrophes historiques de la modernité. >
------
Oulipo écriture mécanique, perte de son utilité descriptive/fictionelle
-> son propre imaginaire / vocablaire :
<
Les arts littéraires, sous OuLiPo, ne sont plus des «arts du vide» ni les lieux d’une «expérience-limite» du langage; ils deviennent les espaces d’un jeu et d’une invention artisanale qui aplatissent toute forme de mythologie littéraire. Le mythe de la littérature, que minait de l’intérieur l’esthétiquenégativedéfinie par Rabaté, se retrouve déboulonné, démonté, défait de l’extérieur par l’esthétiqueoulipienne de l’exhaustivité formelle. La poétique du désœuvrement ‒lieu où l’expérience littéraire devient presque une négativité absolue‒ est remplacée par l’imaginaire prosaïque d’une«littérature-machine»qui ouvre l’écriture à ses potentialités infinies.
>
-----
Au sujet d'un épuisement impossible
( par des subterfuges litteraires @B et @P font semblant d'atteindre l'exhaustivité )
... L'article rappelle leur <fonction descriptive> ( son rôle à produire de la déception )
<
Ce geste esthétique, qui se veut exhaustif, se base sur un artifice propre à la voix narrative –ou plutôt classificatrice– du texte: elle met en scène l’illusion, pleinement assumée, d’une possibilité de la totalité. Loin pourtant de l’univers désincarné des fictions blanchotiennes, le sujet d’énonciation perequien se rapproche ici de la voix narrative de Blanchot: les deux partagent la quête impossible d’une exhaustivité qui, inévitablement, mène l’écriture à l’inachèvement. Comme pour Blanchot, l’épuisement, chez Perec, n’est pas ce qui arrête le geste littéraire; il est ce qui l’alimente. Il est moteur du jeu littéraire et de la mémoire qu’il porte en lui.
>
+
<
Le travail minutieux de catalogage ‒des êtres et des choses qui traversent son présent‒ dévoile le caractère mémoriel de la démarche d’écriture de Perec. Derrière le jeu ludique de la contrainte d’exhaustivité se constitue une tentative d’archivage de la réalité et du présent; l’écriture veut garder en mémoire le présent concret de la place Saint-Sulpice, celle qui a existé du 18 au 20 octobre 1974. Ce n’est pas la dimension historique de l’endroit qui intéresse Perec, mais bien son épaisseur temporelle, le feuilletage sensible des différentes facettes de son réel-présent.
>
@P fait ce jeu dont la contrainte est l'exhaustivité ( tout enregistrer ) de façon profonde ("millefeuil") là ou ta base de données et étalée dans le temps !
-----
Une tache (capter le présent) vouée à l'échec (infinie)
<
En réaction à l’accélération du temps que suppose le présentisme de notre ère, la poétique perequienne de l’épuisement est une pratique mémorielle qui cherche à écrire l’envers du récit historique: elle cherche à écrire une histoire différentielle, l’histoire d’un réel et d’un présent qui, inévitablement, sont toujours en train de nous glisser entre les mains.
>
-----
1) Le labyrinthe et l'oubli.
Fondements d'un imaginaire
Bertrand GERVAIS
https://oic.uqam.ca/wp-content/uploads/2013/06/cf6-2-gervais-le_labyrinthe_et_loubli.pdf
2) Bertrand Gervais "l'effacement radical"
https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2002-v30-n3-pr542/006869ar.pdf
R))
L'épuisement littéraire/artistique ou comment s’intéresser sur le banal, sur ce qui ne faisait pas art/litterature.... avant que Blanchot et autres ne défassent ce qui faisait l'auteur et réinventent leur art.
R) < L’article qui suit détaille deux cas littéraires qui articulent, chacun à sa manière, la logique de l’épuisement: le cas des fictions de Maurice Blanchot, qui prennent comme centre l’exténuation de la voix narrative, et celui de la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec, qui se présente comme un travail exhaustif d’inventaire du réel. >
-----
Blanchot, récit du désœuvrement + chambre ::::::
< Frances A. Yates (Yates, 1966), selon laquelle les Ars memoriae antiques sont en fait des manières d’articuler des espaces imaginaires de la mémoire (Yates, 1966), il est possible de lire les arts du récit de Blanchot comme des architectures mémorielles. Les «lieux» que ceux-ci cherchent à instituer ‒ceux des chambres et des pièces closes où errent ses personnages fictionnels‒ peuvent certes se comprendre comme les gouffres de l’oubli, mais aussi comme les facettes plurielles d’une mémoire alitée, immobilisée et exténuée, qui possède sa propre temporalité. >
+ R)
< [...] l’œuvre blanchotienne fut, par sa poétique du désœuvrement et de l’épuisement, un refus radical de la mythification de la littérature >
+
mort du sujet (litterraire, auteur, sujet)
< L’écriture fictionnelle de Blanchot, qui se veut le lieu où le sujet trouve la mort,n’est pas la simple négation de la subjectivité narrative et de l’écrivain. Elle est la cristallisation d’une poétique de l’épuisement à travers laquelle le sujet, loin d’être nié, retrace ses contours sous la forme spectrale et désœuvrée d’un être «qui suppose sa mort antérieure».À la fois architectures de l’oubli et de la mémoire, cette poétique garde en elle les traces d’une narrativité et d’une subjectivité autre qui, à l’orée même de sa disparition, mettent en lumière la figure de l’écrivain anonyme. Dès lors, c’est le mythe même de la littérature, mais aussi, en filigrane, la figure de l’écrivain moderne qui – disparaissant et s’effaçant dans le langage littéraire – [...] >
C)
< Si Blanchot tente d’épuiser la littérature de l’intérieur, ce n’est que mieux rétablir l’éclat de son mythe et sa mémoirequi en sont venus à se fragmenter à travers les désastres et les catastrophes historiques de la modernité. >
------
Oulipo écriture mécanique, perte de son utilité descriptive/fictionelle
-> son propre imaginaire / vocablaire :
<
Les arts littéraires, sous OuLiPo, ne sont plus des «arts du vide» ni les lieux d’une «expérience-limite» du langage; ils deviennent les espaces d’un jeu et d’une invention artisanale qui aplatissent toute forme de mythologie littéraire. Le mythe de la littérature, que minait de l’intérieur l’esthétiquenégativedéfinie par Rabaté, se retrouve déboulonné, démonté, défait de l’extérieur par l’esthétiqueoulipienne de l’ formelle. La poétique du désœuvrement ‒lieu où l’expérience littéraire devient presque une négativité absolue‒ est remplacée par l’imaginaire prosaïque d’une«littérature-machine»qui ouvre l’écriture à ses potentialités infinies.
>
-----
Au sujet d'un épuisement impossible
( par des subterfuges litteraires @B et @P font semblant d'atteindre l' )
... L'article rappelle leur <fonction descriptive> ( son rôle à produire de la déception )
<
Ce geste esthétique, qui se veut exhaustif, se base sur un artifice propre à la voix narrative –ou plutôt classificatrice– du texte: elle met en scène l’illusion, pleinement assumée, d’une possibilité de la totalité. Loin pourtant de l’univers désincarné des fictions blanchotiennes, le sujet d’énonciation perequien se rapproche ici de la voix narrative de Blanchot: les deux partagent la quête impossible d’une qui, inévitablement, mène l’écriture à l’inachèvement. Comme pour Blanchot, l’épuisement, chez Perec, n’est pas ce qui arrête le geste littéraire; il est ce qui l’alimente. Il est moteur du jeu littéraire et de la mémoire qu’il porte en lui.
>
+
<
Le travail minutieux de catalogage ‒des êtres et des choses qui traversent son présent‒ dévoile le caractère mémoriel de la démarche d’écriture de Perec. Derrière le jeu ludique de la contrainte d’ se constitue une tentative d’archivage de la réalité et du présent; l’écriture veut garder en mémoire le présent concret de la place Saint-Sulpice, celle qui a existé du 18 au 20 octobre 1974. Ce n’est pas la dimension historique de l’endroit qui intéresse Perec, mais bien son épaisseur temporelle, le feuilletage sensible des différentes facettes de son réel-présent.
>
@P fait ce jeu dont la contrainte est l' ( tout enregistrer ) de façon profonde ("millefeuil") là ou ta base de données et étalée dans le temps !
-----
Une tache (capter le présent) vouée à l'échec (infinie)
<
En réaction à l’accélération du temps que suppose le présentisme de notre ère, la poétique perequienne de l’épuisement est une pratique mémorielle qui cherche à écrire l’envers du récit historique: elle cherche à écrire une histoire différentielle, l’histoire d’un réel et d’un présent qui, inévitablement, sont toujours en train de nous glisser entre les mains.
>
-----
1) Le labyrinthe et l'oubli.
Fondements d'un imaginaire
Bertrand GERVAIS
https://oic.uqam.ca/wp-content/uploads/2013/06/cf6-2-gervais-le_labyrinthe_et_loubli.pdf
2) Bertrand Gervais "l'effacement radical"
https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2002-v30-n3-pr542/006869ar.pdf